Se Repérer dans le Ciel |
- Super, ce soir on peut voir les Pléiades à l'oeil nu !!! - Où ça ?
Cette question, on l'a tous entendue ! Pourtant, localiser les étoiles principales du ciel boréal est à la portée de tous. Quelques repères, et hop, le tour est joué. Vous allez pouvoir épater vos copains et copines.
Commençons tout d'abord par reconnaître la Grande Ourse, puis l'étoile Polaire. A partir de ces bases, nous apprendrons à localiser Arcturus, Véga, Capella, Altaïr, puis Deneb, le couple Castor et Polllux, et le W de Cassiopée. Notre balade nous amènera jusqu'à Orion en passant par Sirius, Aldébaran et les superbes Pléiades.
Alors, on commence ?
L'Etoile Polaire (la Petite Ourse) Castor et Pollux (les Gémeaux) Sirius (le Grand Chien), Aldébaran (le Taureau), les Pléiades (le Taureau)
|
|
Composée de 7 étoiles principales d'un éclat assez semblable, la constellation de la Grande Ourse (Ursa Major) est facilement repérable dans le ciel.
La Grande Ourse, le Chariot, la Charrue, la grande Casserole, sont les noms couramment utilisés pour désigner la plus ancienne et la plus connue des constellations. Ses étoiles principales se nomment Dubhe (alpha), Mérak (beta), Phecda (gamma), Megrez (delta), Alioth (epsilon), Mizar (dzêta) et Alkaïd (êta). Avec une bonne vue, à l'oeil nu, on peut distinguer auprès de Mizar une étoile un peu moins brillante, Alcor. Les deux étoiles formant ce célèbre couple optique sont en réalité éloignées d'environ 3 années-lumière.
La Grande Ourse est la plus grande constellation du ciel boréal par la superficie. Son dessin caractéristique permet de localiser facilement la position de l'étoile polaire située dans la constellation de la Petite Ourse (Ursa Minor).
|
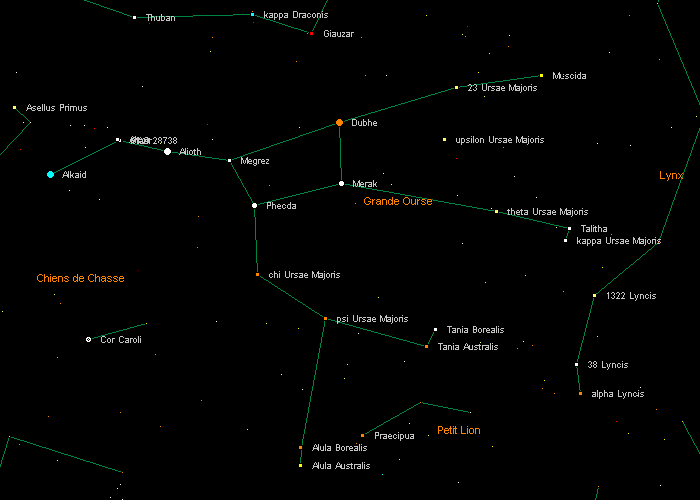
En prolongeant d'environ cinq fois la distance qui sépare Mérak de Dubhe, (deux des étoiles de la Grande Ourse), se trouve l'Etoile polaire ou Polaris (alpha Ursae Minoris). Le ciel de l'hémisphère nord semble tourner autour d'elle.
Située à environ 1 degré d'arc du pôle Nord céleste, Polaris se situe toujours dans la direction du nord, et sert de repère pour trouver le pôle Nord céleste. Il s'agit d'une étoile géante jaunâtre, une étoile variable pulsante de type céphéide qui semble désormais arrivée à la fin de son stade variable. Sa lumière met environ 430 ans pour nous parvenir.
Du fait du mouvement de précession de l'axe de rotation de la Terre, la position du pôle Nord céleste change. En 2102, l'Etoile polaire sera au plus près du pôle céleste Nord, puis s'en écartera progressivement. Vers l'an 14000, la nouvelle étoile indiquant le Nord céleste sera Véga.
|

En prolongeant de presque cinq fois la droite joignant Dubhe à Megrez de la Grande Ourse, on trouve Arcturus (alpha Bootis). D'une couleur légèrement orangée, c'est la plus brillante des étoiles visibles dans l'hémisphère Nord au printemps, située dans la constellation du Bouvier (Bootes). Sa lumière met 36,7 années pour nous parvenir.
Le nom d'Arcturus signifie « gardien de l'ours(e) » en grec. La constellation du Bouvier est une constellation très ancienne, déjà connue sous ce nom des anciens Sumériens.
C'est l'une des 48 constellations anciennes répertoriées par le grec Ptolémée au IIè siècle. Pour les romains, le Bouvier était le pasteur qui gardait le troupeau de sept boeufs (septem triones) représentés par les sept étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse.
|

Pour localiser Véga, relions par une ligne droite Polaris à Alkaïd (dans la Grande Ourse). En direction opposée à la Grande Ourse, traçons une perpendiculaire d'une longueur légèrement supérieure à la distance Polaris-Alkaïd.
Véga (alpha Lyrae) est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel estival dans l'hémisphère Nord, et compose avec Deneb (dans le Cygne) et Altaïr (de la constellation de l'Aigle), le célèbre « Triangle d'été ».
De teinte bleutée et située à 25,3 années-lumière de la Terre, Véga est l'étoile principale de la petite et très ancienne constellation de la Lyre (Lyra).
La légende grecque dit que c'est l'instrument inventé par le dieu Hermès qui fut donné par son père Apollon à Orphée, le musicien des Argonautes. Pour les astronomes arabes, la constellation représentait « l'aigle en piqué », Al Nasr Al Waki. Le nom de Véga provient d'une simplication de ce nom.
|

Traçons une droite joignant Dubhe (dans la Grande Ourse) à l'Etoile Polaire. A partir de Polaris, élevons une perpendiculaire dans le prolongement du petit attelage. A une distance d'environ une fois et un tiers la distance Duhbe-Polaris, se trouve Capella, l'une des étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord, et d'une couleur légèrement jaune, située dans la constellation du Cocher (Auriga). Capella (alpha Aurigae) est située à 42,2 années-lumière de notre planète.
Le Cocher est une constellation très ancienne, déjà connue sous ce nom par les Grecs, et représentée sur les vielles cartes célestes sous les traits d'un homme portant sur son dos une chèvre, suivi par deux ou trois petits. Capella signifie « Petite Chèvre ». Selon la mythologie grecque, le Cocher était le fils du roi Erichtonios, premier homme à avoir attelé quatre chevaux à un chariot.
|

Altaïr est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère boréal, et forme avec Deneb (dans la constellation du Cygne) et Véga (de la Lyre), le « Triangle d'été ». On peut également la localiser en prolongeant d'environ deux tiers la ligne imaginaire reliant Alkaïd (dans la Grande Ourse) à Véga.
Altaïr (alpha Aquilae), située très près de l'équateur céleste, disparaît derrière notre horizon entre Mai et Octobre pour nos régions. De couleur blanche, Altaïr est située à 16,8 années-lumière de la Terre en direction de la constellation de l'Aigle (Aquila) dont elle est l'étoile principale.
A l'origine, la constellation représentait l'Aigle en lequel Jupiter se transforma pour enlever Ganymède, le plus beau des mortels, dont s'était épris le dieu de l'Olympe. Les Romains y voyaient l'oiseau emportant le corps du bel Antinoüs, favori de l'empereur Adrien, qui s'était noyé dans le Nil.
|

En partant de Megrez, l'étoile centrale de la Grande Ourse, il suffit de relier l'étoile arrière de la Petite Ourse, et de prolonger environ deux fois la distance séparant les deux chariots, pour trouver l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne : Deneb.
Deneb (alpha Cygni) forme avec Véga (de la Lyre) et Altaïr (dans l'Aigle), le célèbre « Triangle d'été ». La distance exacte de la Terre de cette étoile supergéante bleue-blanche est mal connue. Selon les sources, Deneb est située entre 1600 et 3200 années-lumière de la Terre.
La constellation du Cygne (Cygnus) représente la forme que prit Jupiter pour séduire Léda, épouse de Tyndare, roi de Sparte. Les astronomes arabes du Xème siècle appelaient cette constellation « La Poule », référence que l'on retrouve dans le nom de l'étoile Deneb (« la Queue », en arabe).
|

Pour trouver Castor et Pollux, il faut prolonger d'environ deux fois la distance reliant Alkaïd à Mérak (toutes deux dans la Grande Ourse), ou environ cinq fois la distance entre Megrez et Mérak (également dans la Grande Ourse).
Castor (alpha Geminorum) présente une teinte orangée, tandis que Pollux (beta Geminorum) est de couleur blanche et un peu plus brillante. Le couple est visible au zénith en hiver. Il disparaît totalement entre Mars et Octobre pour nos régions. Castor et Pollux sont situées à respectivement 51,6 et 33,7 années-lumière de notre planète.
La constellation doit son nom à ses deux étoiles principales : Castor et Pollux, en référence aux deux fils jumeaux que Jupiter eut avec Léda, l'épouse du roi de Sparte.
|

Visible toute l'année depuis nos régions, Cassiopée (Cassiopeia), suivant son orientation par rapport à l'observateur, décrit un « M » ou un « W » caractéristique, à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'Etoile polaire.
Les cinq étoiles principales formant ce dessin imaginaire n'ont pas de liens réels entre elles. Epsilon Cassiopeiae, Rubbach, gamma Cassiopeiae, Schedar et Caph, sont situées respectivement à environ 442, 100, 613, 229 et 54.5 années-lumière de la Terre.
Cassiopée, épouse du roi d'Ethiopie Céphée, offensa Neptune en vantant que sa fille Andromède était plus belle que les nymphes de la mer, ses filles. Le dieu de la mer envoya alors un monstre marin, la Baleine, pour dévaster les côtes du royaume. Céphée, pour calmer la colère du dieu, fit enchaîner sa fille Andromède à un rocher pour l'offrir au monstre. Persée, chevauchant le cheval ailé Pégase, délivra la belle Andromède.
|

En prolongeant la ligne reliant l'Etoile Polaire à Capella (dans le Cocher), on trouve la très belle constellation d'Orion, laquelle domine nos cieux en hiver.
Orion est composée de quatre étoiles lumineuses, Bételgeuse (« l'épaule du géant »), Bellatrix (« la guerrière »), Rigel (« le pied ») et Saïph (« l'épée »), et des trois étoiles de la ceinture, nommées Alnitak, Alnilam et Mintaka, qui forment un bel alignement surnommé « le Baudrier » ou « Les Mages ». La constellation abrite la Grande Nébuleuse d'Orion (M42) ainsi que la Tête de Cheval, les plus connus et les plus photographiés de tous les objets célestes.
C'est la splendeur de la constellation qui incita les Grecs à la nommer Orion, le chasseur géant, poursuivant de ses assiduités les Pléiades, défendues par le Taureau. Orion fut tué par le Scorpion qu'Arthémis aurait fait sortir de terre.
|
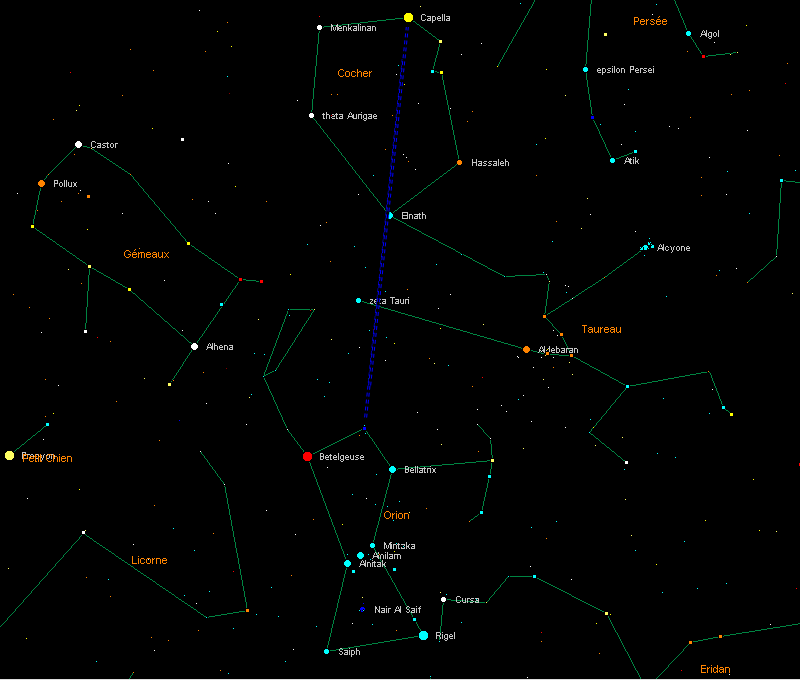
Sirius (le Grand Chien), Aldébaran (le Taureau), les Pléiades (le Taureau) |
Siriux Dans le prolongement des trois étoiles centrales de la constellation d'Orion se trouve Sirius (alpha Canis Majoris), l'étoile la plus lumineuse de notre ciel. Située dans la constellation du Grand Chien (Canis Major), Sirius est également une des étoiles les plus proches que l'on peut admirer dans le ciel d'hiver. Sa lumière met 8,6 ans pour nous parvenir.
La constellation du Grand Chien évoque l'un des deux chiens accompagnant le chasseur Orion, selon la mythologie grecque. Sirius était bien connue dans l'Egypte Antique car sa réapparition à l'aube (lever héliaque) coïncidait avec le début de la crue annuelle du Nil et la période de grande chaleur. Sirius était appelée « canicula », signifiant « petite chienne », par les Romains. Le mot de canicule a traversé les siècles pour désigner une période de grande chaleur.
Aldébaran Dans le prolongement des trois étoiles centrales d'Orion, et à l'opposé de Sirius (de la constellation du Grand Chien), Aldébaran domine la constellation du Taureau (Taurus).
Aldébaran (alpha Tauri), dont le nom signifie « le suiveur » en arabe, suit le bel amas des Pléiades dans le déplacement apparent des étoiles. Reconnaissable à sa teinte rouge-orange, l'étoile géante Aldébaran côtoie l'amas des Hyades (« étoiles de pluie », en grec) sans toutefois en faire partie. Sa lumière met 65 ans pour nous parvenir.
Le Taureau, visible en hiver depuis l'Europe, est sans doute une des constellations les plus anciennes. Les grecs l'associaient à la métamorphose de Zeus en taureau lorsqu'il entreprit d'enlever Io, selon certains, ou Europe, selon d'autres. Pour les Egyptiens, la constellation représentait le boeuf Apis, dieu du Nil.
Les Pléiades L'amas des Pléiades, dénommé également M45, est visible à l'œil nu dans le ciel d'automne, dans le prolongement de la ligne imaginaire reliant les trois étoiles centrales d'Orion à Aldébaran (l'étoile principale du Taureau).
Dans la mythologie grecque, les « Pléiades » sont les filles d'Atlas et de Pléione. Zeus métamorphosa les sept soeurs en colombe pour les soustraire au géant Orion, puis en constellation. Les neuf étoiles principales de l'amas portent le nom des parents, Atlas et Pléione, et des sept soeurs : Mérope, Alcyone, Celaeno, Electra, Taygeta, Astérope, et Maia. De prime abord, 6 à 7 étoiles sont visibles à l'oeil nu, mais un ciel bien sombre exempt de lumières parasites et une très bonne vue permettront d'apercevoir entre 9 et 12 étoiles. L'amas dévoile toute sa beauté aux jumelles en révélant une trentaine d'étoiles.
|
